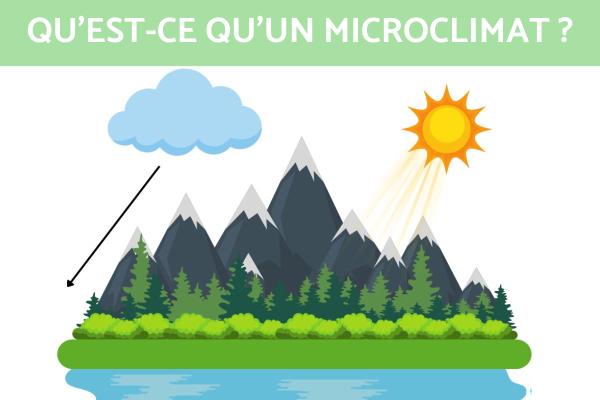
Dans l'étude du climat, il existe des phénomènes à petite échelle qui influencent directement les conditions environnementales de zones très spécifiques. L'un d'entre eux est le microclimat, défini comme l'ensemble des caractéristiques climatiques propres à une petite zone, qui diffèrent du climat général qui l'entoure. Ce type de climat local peut être observé dans des zones aussi petites qu'un jardin, un flanc de colline ou une rue urbaine, et résulte de l'interaction de facteurs physiques et environnementaux spécifiques au site.
Dans cet article de ProjetEcolo, on vous explique en détails ce qu'est un microclimat, comment il se forme et on illustre le tout avec quelques exemples triés sur le volet !
Bonne lecture !
Qu'est-ce qu'un microclimat - Définition
Un microclimat est un ensemble de conditions climatiques particulières se produisant dans une zone très localisée, qui peut être considérablement différente du climat général prévalant dans la région plus large où elle se trouve. En d'autres termes, au sein d'une même ville, d'un même village, d'une même vallée ou même d'un même jardin ou d'une même pièce, il peut y avoir des variations de température, d'humidité, de vent, d'ensoleillement ou de précipitations qui constituent un climat à part entière : un microclimat.
Ce qui caractérise un microclimat, c'est non seulement sa petite échelle, mais aussi sa capacité à rester relativement stable et distinct de l'environnement au sens large. Bien que ces différences puissent sembler minimes d'un point de vue global, elles sont suffisamment importantes pour influencer le développement de la végétation, le comportement des animaux et même la façon dont les gens construisent leurs maisons ou gèrent leurs cultures.
Par exemple, dans une zone géographique où le climat général est sec et chaud, il peut y avoir une zone spécifique avec une plus grande concentration d'humidité ou une température légèrement plus fraîche en raison des caractéristiques locales du terrain. Ce type de situation se produit dans de nombreuses régions du monde et est fondamental pour comprendre comment les éléments de l'environnement interagissent à petite échelle.

Formation d'un microclimat
La formation d'un microclimat est le résultat de l'interaction entre divers éléments de l'environnement physique qui modifient les conditions atmosphériques locales. Alors que le climat global d'une région est déterminé par des phénomènes à grande échelle, les microclimats sont générés par des facteurs beaucoup plus spécifiques, proches du sol. Ces facteurs agissent comme des modulateurs du climat, créant de petites « bulles » aux conditions différentes de celles qui prévalent dans leur environnement immédiat.
Voyons ensemble les facteurs qui influencent la formation d'un microclimat :
- Topographie : la forme du terrain est l'un des éléments les plus déterminants. Montagnes, collines, vallées, pentes ou dépressions modifient la circulation de l'air, l'exposition au soleil et l'accumulation d'humidité.
- Altitude : elle a un impact direct sur la température et la pression atmosphérique. Plus on monte en altitude, plus l'air devient frais et moins dense. La végétation et la faune changent également rapidement avec l'altitude en réponse à ces différences.
- Plans d'eau : la présence de rivières, de lacs, d'étangs ou de la mer influence l'humidité et la régulation thermique de l'environnement. L'eau a une grande capacité de rétention de la chaleur, ce qui atténue les variations de température entre le jour et la nuit.
- Couverture végétale : la végétation agit comme un isolant thermique naturel. Les zones boisées, par exemple, ont tendance à être plus fraîches et plus humides que les espaces ouverts en raison de l'ombre des arbres et de l'évapotranspiration. Même en milieu urbain, la présence de parcs et de jardins peut réduire la température ambiante locale, diminuer la vitesse du vent et augmenter l'humidité.
- Type de sol et couleur de la surface : les sols sombres ou asphaltés absorbent plus de chaleur que les sols clairs ou envahis par la végétation, ce qui augmente la température de l'environnement. De même, les sols sablonneux se réchauffent plus rapidement, mais retiennent moins l'humidité que les sols argileux, ce qui peut modifier les conditions thermiques et d'humidité dans une petite zone.
- Constructions humaines et urbanisme : la disposition des bâtiments, l'orientation des rues, la présence ou l'absence d'arbres et la densité des infrastructures peuvent modifier la circulation de l'air, le rayonnement solaire et l'accumulation de chaleur.
- Vent : la vitesse et la direction du vent influencent directement le refroidissement éolien, l'évaporation de l'eau et la ventilation naturelle d'un site.
- Orientation solaire : l'orientation d'un espace par rapport au soleil influe sur la quantité de rayonnement solaire qu'il reçoit. Ce facteur est particulièrement important sur les terrains en pente ou dans les bâtiments, où les façades orientées vers le sud (dans l'hémisphère nord) ou vers le nord (dans l'hémisphère sud) reçoivent plus d'heures d'ensoleillement direct.

Exemples de microclimats
Concluons cette petite introduction sur les microclimats avec quelques exemples :
- Microclimats urbains (îlots de chaleur) : l'un des exemples les plus connus de microclimats est le phénomène de l'« îlot de chaleur urbain ». Dans les grandes villes, la concentration de bâtiments, de routes, de voitures et de surfaces asphaltées absorbe et retient plus de chaleur que les zones rurales environnantes. Par conséquent, la température dans le centre d'une ville peut être supérieure de plusieurs degrés à celle de la zone environnante, surtout la nuit. Cet effet est renforcé en l'absence de végétation et atténué dans les zones dotées de parcs, d'arbres ou de jardins verticaux.
- Microclimats dans les jardins ou les cours : même dans de très petits espaces, tels qu'une arrière-cour ou un jardin, des microclimats peuvent se former. Par exemple, un coin du jardin orienté au sud peut recevoir plus de soleil et donc être plus chaud et plus sec qu'une zone ombragée par un mur ou un arbre. Cela influence directement les types de plantes qui peuvent prospérer dans tel ou tel coin du même jardin.
- Vallées et dépressions : les vallées profondes et fermées ont tendance à retenir l'air froid pendant la nuit, ce qui créé des microclimats plus frais que les pentes ou les zones plus élevées. Ce phénomène est connu sous le nom d'inversion thermique.
- Pentes des montagnes : dans l'hémisphère nord, les pentes orientées vers le sud ont tendance à recevoir plus de lumière du soleil, ce qui se traduit par un microclimat plus chaud et plus sec, tandis que les pentes nord sont plus fraîches et plus humides.
- Environnements côtiers : les zones proches de la mer, des lacs ou des grands fleuves ont tendance à avoir des microclimats plus doux qu'à l'intérieur des terres. La masse d'eau agit comme un régulateur thermique : pendant la journée, elle absorbe la chaleur du soleil et la nuit, elle la libère lentement, réduisant ainsi les extrêmes thermiques.
- Grottes et ravins : les grottes profondes, les crevasses ou les ravins peuvent maintenir un microclimat frais et humide tout au long de l'année, même s'ils sont situés dans des régions chaudes. Cela est dû à l'absence d'exposition solaire directe et d'accumulation d'humidité.
- Serres et structures artificielles : une serre est un exemple classique de microclimat créé artificiellement. Grâce à sa structure fermée et transparente, elle piège l'énergie solaire, maintient une température élevée et régule l'humidité, ce qui permet de cultiver des plantes hors saison ou hors de leur climat naturel.
- Zones agricoles protégées : En agriculture, les agriculteurs profitent des microclimats pour améliorer leur productivité. Par exemple, une plantation située sur une pente ensoleillée ou à l'abri du vent peut mûrir plus rapidement ou produire des fruits de meilleure qualité qu'une plantation voisine ne bénéficiant pas de ces conditions.
- Oasis dans les zones désertiques : les oasis sont des microclimats exceptionnels dans les régions arides. La présence d'eau souterraine ou de sources crée de petites zones de végétation, d'humidité et d'ombre, entourées de déserts chauds et secs.
- Zones forestières dans les régions chaudes : une forêt dense peut créer un microclimat plus frais et plus humide que les espaces ouverts environnants. Le couvert végétal réduit la lumière directe du soleil, tandis que l'évapotranspiration contribue à augmenter l'humidité de l'air.
Si vous souhaitez lire plus d'articles semblables à Microclimat : définition, formation et exemples, nous vous recommandons de consulter la catégorie Environnement (autres).
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2022, 17 de marzo). Microclimate. Encyclopaedia Britannica. Disponible sur : https://www.britannica.com/science/microclimate
- StudySmarter. (s. f.). Microclima: Factores, Importancia. StudySmarter España. Disponible en: https: https://www.studysmarter.es/resumenes/ciencias-ambientales/entorno-vivo/microclima/
- García, C. (2014). Microclima, macroclima y sus elementos. SlideShare. Disponible sur : https://es.slideshare.net/slideshow/microclima-macroclima-y-sus-elementos/32679927